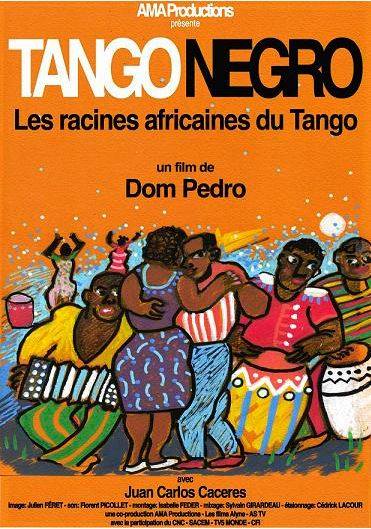 Sans le Tango, qui aurait su que l’Argentine fut autrefois peuplée de Noirs, et que leur histoire est liée à celle du pays de la pampa ? C’est à la question des origines de cette danse, et, au-delà, des origines africaines d’une partie du peuple argentin, que Dom Pedro, né en Angola, a réalisé Tango Negro. Le film a été projeté lors du FIFDA, en septembre dernier, au Comptoir Général de Paris. Retour sur une aventure musicale et historique saisissante, avec le réalisateur.
Sans le Tango, qui aurait su que l’Argentine fut autrefois peuplée de Noirs, et que leur histoire est liée à celle du pays de la pampa ? C’est à la question des origines de cette danse, et, au-delà, des origines africaines d’une partie du peuple argentin, que Dom Pedro, né en Angola, a réalisé Tango Negro. Le film a été projeté lors du FIFDA, en septembre dernier, au Comptoir Général de Paris. Retour sur une aventure musicale et historique saisissante, avec le réalisateur.
Sur le fil du temps : de Ntangu à Tango
Sur une place de Buenos Aires, un couple danse. Une pointe de désespoir se lit, souvent, dans le regard des partenaires, au moment de se détacher l’un de l’autre. Puis ils se raccrochent l’un à l’autre, comme en dérive, et la femme fait une moue de résignation.
Ensuite, apparaît la photo d’une famille de Noirs dont les ancêtres furent emmenés de force en Argentine. « Le Tango, c’est trois temps de tristesse », entend-on : celle de l’immigré, celle du gaucho, et celle, moins connue, de l’esclave arraché à sa terre natale. Cette « danse de salon », affiliée à une strate élevée de la société argentine d'origine européenne, puise ses racines en Afrique, jusqu’à son nom même : Tango vient de Ntangu, ou le temps qui passe, affirme un musicologue.
Et du temps a passé, depuis l’arrivée des Noirs issus de la traite négrière du 18ème siècle sur le territoire Argentin, depuis qu’ils ont servi de chair à canon lors de la guerre d’indépendance du pays, lors du même siècle.
Aujourd’hui, un Noir en Argentine suscite l’interrogation, et est souvent confondu avec un Uruguayen. Il faut effectuer une remontée dans le temps pour s’apercevoir que les deux pays ont eu le même passé esclavagiste.
Pour le réalisateur, le voyage dans le temps permet de résoudre un mal plus profond, celui de l’identité africaine, dont les éclats se lisent un peu partout dans le monde : « le but est non seulement de contribuer à la connaissance du monde, mais aussi à nous réapproprier nos valeurs culturelles africaines présentes sur tous les continents ».
La musique, thérapie d’un peuple
Ce qui est troublant, derrière la caméra de Dom Pedro, c’est la similitude des mouvements effectués par les danseurs avec certaines danses africaines, comme le Soumou du Mali. Troublante aussi, la mélancolie de la mélodie et de la voix qui chante. C’est comme si le chanteur, quelque part en lui, portait un héritage qui survit au silence par le biais de sa voix. Un sentiment que partage l’auteur : « Ce film est d'abord une thérapie personnelle; tout au long de ma vie. Je crois que les conditions de déportation, de souffrances et de dépaysement sont à la base de la mélancolie et de la nostalgie. Personnellement, je sens encore vibrer dans mes veines les souffrances endurées par tous ceux des nôtres victimes des traitements inhumains au cours des siècles passés. Et si les spectateurs concernés peuvent se sentir réconfortés et revigorés en regardant ce film, la thérapie devient alors collective. C'est en fait une recherche de "réparation" autant morale que physique; car il nous la faut pour conjurer le mauvais sort en relation avec un certain passé depuis révolu. Voilà pourquoi je souhaite que ce film soit vu par un grand nombre des gens, aussi bien Africains que du reste du monde. On est voués à la même enseigne ! ».
Guérir le passé par la musique, donc. Pour permettre aux générations futures de mieux appréhender le monde.
Le défi des générations futures
Des générations qui devront « reprendre ce que nous aurons laissé en suspens ».
Celles-ci auront à marcher sur le fil d’une histoire à double tranchant : d’un coté, le piège de l’afrocentrisme, de l’autre celui de l’amnésie culturelle. Une menace contre laquelle l’auteur met en garde les jeunes afro-descendants d’aujourd’hui, et les jeunes en général : « alors que les uns croiront toujours à des images « façonnées » à l’avantage de certains, d’autres resteront accrochés à ce qu’ils considèrent comme une vérité intrinsèquement biblique ! ».
Il y a donc à s’écouter les uns les autres, afin d’éviter que prospère ce climat de « méfiance » inter-culturelle que l’on peut déceler aujourd’hui.
Le voyage…des mots
Mais Tango Negro se situe bien au-delà de l’histoire d’une danse. Si la musique est l’élément dominant, c’est la quête d’une terre ancestrale originelle, d’un berceau tantôt prêté à l’humanité, tantôt relégué au dernier plan, comme on peut l’entendre dans la chanson de cette femme Argentine dont les mots comportent de curieuses consonances Yoruba. « C’est indéniable, l’Afrique a été précurseur de bien des courants dont le reste l’humanité s’est enorgueillie sans vergogne. Et le Tango est peut-être l’un de ces courants. Beaucoup de mots ou d’expressions dans le parlé et dans la célébration des rituels religieux dans l’ensemble des pays d’Amérique latine sont d’obédience « kongo ». Et, lors de mon passage en Argentine et en Uruguay, j’ai observé que les populations usent de ces mots sans en connaitre réellement la signification ! ».
La langue, c’est bien connu, est le véhicule de l’histoire. C’est pourquoi le réalisateur exhorte les chercheurs en sciences humaines d’Afrique et d’Amérique Latine à construire entre les deux continents des ponts, des groupes de travail pour retracer les origines de ces mots. Des mots comme Nkumba, nom d’une danse du bassin du Congo, dont le nom a peu à peu dérivé en Rumba.
C’est que la guerre d’indépendance a effacé, en occasionnant la mort de centaines de milliers de militaires originaires d’Afrique, toute trace d’une contribution de ceux-ci à l’héritage culturel argentin. Si certains pourraient attribuer au film un coté « orienté », ils n’en seraient pas moins enchantés par la poésie et la charge émotionnelle dont il est imprégné, de la mélancolie du début à la note d’espoir qui le clôture.
Touhfat Mouhtare


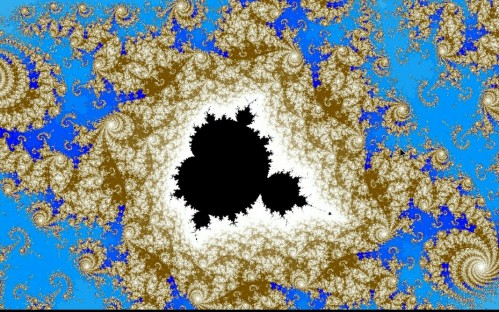 Picture 2 : Mandelbrot Set
Picture 2 : Mandelbrot Set

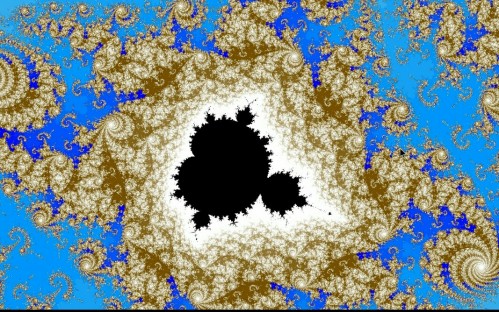

 Lorsqu’on parle du Green Business en Afrique, la première idée qui émerge est celle de l’énergie solaire pour pallier l’accès difficile à l’électricité. A eux seuls, l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne comptent 80% des 1,5 milliard d’habitants lésés par une alimentation électrique défaillante, faute de moyens techniques et financiers.
Lorsqu’on parle du Green Business en Afrique, la première idée qui émerge est celle de l’énergie solaire pour pallier l’accès difficile à l’électricité. A eux seuls, l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne comptent 80% des 1,5 milliard d’habitants lésés par une alimentation électrique défaillante, faute de moyens techniques et financiers. Alors que le monde entier célèbre le vingtième anniversaire du tragique génocide rwandais, au Burundi, on déplore le vingtième anniversaire d’un assassinat. Celui de Melchior Ndadaye, président du Burundi de juin à octobre 1993, qui faisait partie de la majorité Hutu. Une tentative de coup d’Etat suivie de près par le massacre de milliers de Tutsi, minoritaires au Burundi, puis d’une escalade de violence qui fait écho à celle qui sévissait au Rwanda à la même période. Frontalier du Rwanda, avec lequel il partage certains aspects démographiques, le Burundi a lui aussi été le théâtre de massacres entre Hutu et Tutsi. Représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé à Bujumbura au moment des faits, le Dr Mouhtare Ahmed revient sur les constats réalisés par une équipe de l'ONU dépêchée sur les lieux entre 1994 et 1995, et sur sa propre expérience.
Alors que le monde entier célèbre le vingtième anniversaire du tragique génocide rwandais, au Burundi, on déplore le vingtième anniversaire d’un assassinat. Celui de Melchior Ndadaye, président du Burundi de juin à octobre 1993, qui faisait partie de la majorité Hutu. Une tentative de coup d’Etat suivie de près par le massacre de milliers de Tutsi, minoritaires au Burundi, puis d’une escalade de violence qui fait écho à celle qui sévissait au Rwanda à la même période. Frontalier du Rwanda, avec lequel il partage certains aspects démographiques, le Burundi a lui aussi été le théâtre de massacres entre Hutu et Tutsi. Représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé à Bujumbura au moment des faits, le Dr Mouhtare Ahmed revient sur les constats réalisés par une équipe de l'ONU dépêchée sur les lieux entre 1994 et 1995, et sur sa propre expérience.
 Ndadaye : « ils ont tué Ndadaye, mais ils n’ont pas tué tous les Ndadaye ».
Ndadaye : « ils ont tué Ndadaye, mais ils n’ont pas tué tous les Ndadaye ».
 Nombre de spécialistes aujourd'hui parlent de l'émergence du web en Afrique, où les utilisateurs s'adaptent aux usages de ce moyen de communication, s'approprient le numérique et développent de nouveaux usages. Internet permettrait de casser les barrières de l'ignorance qui ont longtemps séparé les Africains du savoir, de la technologie, du progrès. Les géants du web leur offrent généreusement cette opportunité en proposant des interfaces en langues locales et des plateformes semblables à l'arbre à palabres. On pourrait demeurer engoncé dans cette image d'une Afrique toujours apprenante, brave élève à la traîne qui redouble d'efforts pour égaler les autres. Seulement voilà : depuis la fin des années 1990, des chercheurs soulèvent une question qui pourrait bouleverser cette perception. Le codage numérique des données, qui a fait de la machine notre compagnon, puiserait ses racines dans toutes les civilisations. Et si son adaptation par les Africains n'était rien d'autre que la récupération d'un patrimoine local ?
Nombre de spécialistes aujourd'hui parlent de l'émergence du web en Afrique, où les utilisateurs s'adaptent aux usages de ce moyen de communication, s'approprient le numérique et développent de nouveaux usages. Internet permettrait de casser les barrières de l'ignorance qui ont longtemps séparé les Africains du savoir, de la technologie, du progrès. Les géants du web leur offrent généreusement cette opportunité en proposant des interfaces en langues locales et des plateformes semblables à l'arbre à palabres. On pourrait demeurer engoncé dans cette image d'une Afrique toujours apprenante, brave élève à la traîne qui redouble d'efforts pour égaler les autres. Seulement voilà : depuis la fin des années 1990, des chercheurs soulèvent une question qui pourrait bouleverser cette perception. Le codage numérique des données, qui a fait de la machine notre compagnon, puiserait ses racines dans toutes les civilisations. Et si son adaptation par les Africains n'était rien d'autre que la récupération d'un patrimoine local ?