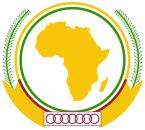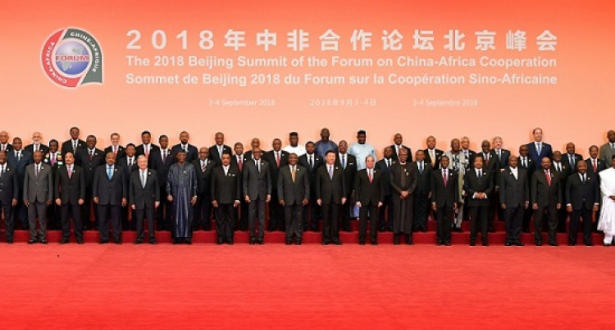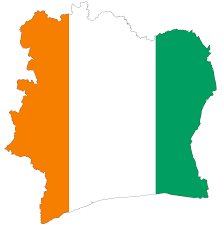La Modernité pourrait se définir par la distinction épistémologique fondatrice sujet / objet et découlant de celle-ci la production de l’opposition structurante nature / culture. Ce rapport au Monde, détachant l’Homme de la Nature et le plaçant en surplomb, permit l’élaboration et le développement de technologies d’exploitation des ressources de la nature, pensées alors comme illimitées, au profit de l’espèce humaine (anthropocène), ou plutôt de l’échantillon d’elle qui s’était érigé en étalon de l’humanité (capitalocène ou occidentalocène).
La Modernité pourrait se définir par la distinction épistémologique fondatrice sujet / objet et découlant de celle-ci la production de l’opposition structurante nature / culture. Ce rapport au Monde, détachant l’Homme de la Nature et le plaçant en surplomb, permit l’élaboration et le développement de technologies d’exploitation des ressources de la nature, pensées alors comme illimitées, au profit de l’espèce humaine (anthropocène), ou plutôt de l’échantillon d’elle qui s’était érigé en étalon de l’humanité (capitalocène ou occidentalocène).
Cette ontologie moderne aura en fait été le principal moteur de l’imperium européen dans son projet de domestication et d’exploitation de la Nature mais aussi de toute autre forme d’altérité culturelle.
Aujourd’hui, cette modalité culturellement située de représentation des interactions entre les activités humaines et le reste des entités du vivant, humain et non humain pour le dire dans des termes latouriens, se heurte aux signes alarmants révélant l’infinie complexité des actions et des rétroactions des différents êtres composant le système Terre.
L’Homme, occupant désormais l’espace d’une force géologique, influe globalement sur l’histoire récente du système Terre. Mais, comme Marx le faisait déjà remarquer pour l’histoire des sociétés humaines : « l’Homme fait l’histoire mais il ne sait pas l’histoire qu’il fait ». Ainsi la puissance acquise par l’espèce humaine, désormais capable de modifier la trajectoire du climat, l’acidité des océans, la biodiversité, etc. révèle, paradoxalement, une impuissance tout aussi vertigineuse.
Et il est tout à fait troublant de constater que la perturbation des équilibres qui ont permis jusqu’à présent le maintien, dans des conditions de relative stabilité, de l’espèce humaine trouve son origine la plus immédiate dans les excès du capitalisme et sa sécrétion d’inégalités et d’injustices.
Le projet désormais impératif de déconstruction de la modernité, afin notamment d’essayer de proposer des alternatives politiques crédibles et des institutions démocratiques ad hoc destinées à réduire l’empreinte écologique de l’espèce humaine sur Gaia, doit se nourrir de la multiplicité des discours critiques portés par la cohorte de corps5 que l’effectuation de la modernité, sur ces quelques trois siècles écoulés, aura marginalisé ou marchandisé (critique féministe, critique post-coloniale, critique queer, etc.).
Cette réflexion se propose de poser les pistes de la spécificité d’une contribution africaine, pensée à partir de son historicité propre, pour appréhender les nouveaux enjeux globaux, en formulant la question suivante :
L’Afrique est-t-elle parmi les lieux que l’on puisse privilégier pour penser l’effectuation moderne du Monde afin de mieux comprendre et déjouer le réseau d’asymétries tendues qu’elle a tracé, au cours des derniers siècles, dans la valeur de la vie et du vivant?
L’Afrique au cœur des marges de la Modernité
De part et d’autre de la science, les spécialistes ne cessent plus de tirer la sonnette d’alarme et de s’interroger: l’Homme serait rentré dans une course poursuite contre lui-même. Comment donc sortir de cette effectuation moderne prédatrice qui nous mène vers notre extinction ?
Peut-être, conviendrait-il de prendre pour point de départ des espaces en résistance contre le projet moderne. En résistance, justement parce que le projet moderne a, d’une certaine manière, contribué à les exclure d’un sanctuaire des privilèges qu’il travaillait à faire advenir et auquel il assujettissait tout le reste, ou presque. C’est donc qu’à partir de ces lieux sujets, de ces marges, que nous souhaiterions penser ce qui pourrait être un enversde la Modernité. Non pas qu’il s’agisse, dans la fièvre d’une pureté toute révolutionnaire de détruire la Modernité et l’ensemble de ses édifices, mais davantage qu’il faille la penser avec ses contraires et ses en-dehors. Et là, force est de constater que certains lieux à la margerecèlent un pouvoir de dévoilement plus important que d’autres (et c’est l’objet de cette réflexion).
Le concept de marge pourrait être défini comme cet espace où le discours du pouvoir sur lui-même se heurte à son mensonge et donne à voir l’ampleur réelle d’une politique sur l’ensemble du vivant. C’est à ce titre un concept d’une grande fécondité heuristique et, pour ce qui nous concerne, un outil conceptuel précieux pour la déconstruction de la Modernité, à partir d’une certaine perspective. En cela, nous nous inscrivons dans la continuité des efforts de Michel Foucault pour lequel, selon Lautier Bruno :
« L’objectif […] n’était pas de « parler des exclus » ; il l’a d’ailleurs fort peu fait dans ses écrits théoriques, il réservait ça à son activité militante. Son objectif était un objectif de méthode : montrer qu’on comprend une société non pas en en faisant une analyse de l’intérieur, mais depuis les marges : les fous, les malades, les criminels, les pervers, ne nous apprennent pas grand-chose sur eux-mêmes, mais beaucoup sur nous. »
Nous proposons ainsi l’hypothèse que l’Afrique constitue cette marge à partir de laquelle la Modernité, comme projet biopolitique, se révèle pour ce qu’elle est véritablement : Lumièrestout autant que Ténèbres.
Afrique, pivot d’un universel de la circulation et du mouvement
Sur un plan méthodologique, à ce premier temps qui est un arrêt sur l’Afrique (conçue comme une margestratégique de la Modernité) doit être agrégé un second temps ancré dans le mouvement. Un mouvement circulaire constant, passant sans cesse d’une expérience historico-culturelle à une autre, d’un mode d’être à un autre. Le mouvement comme fondement et éthique, expression, pour le dire comme Bachir Diagne, d’un universalisme latéral révélé par le processus même de la traduction; mais une traduction élargie permettant tout aussi bien de passer d’une expérience culturelle à une autre (d’une langue à une autre) que d’un mode d’être à un autre (une ontologie à une autre).
A l’évidence,une telle d’approche a vocation à s’écarter de toute logique du ressentiment, portée par un afro-centrisme d’arrière-garde, tout autant que d’une logique de la pitié, même dans ses expressions les plus distinguées, réduisant toujours au final l’Afrique à un manque qu’elle ne saurait, par nature, combler d’elle-même.
L’effort vers ce mouvement circulatoire, questionnant la modernité à partir de tous ses en-dehors, est le prix de l’écriture d’un récit partagé du devenir. Et l’Afrique peut réellement, à partir de son expérience propre (c’est-à-dire celle d’une vulnérabilitédans l’ère moderne), ouvrir de nouveaux possibles sur les enjeux globaux qui traversent les débats intellectuels et politiques contemporains, couvrant d’une extrémité à une autre la question de la survie de l’Homme (pour les plus pessimistes) ou plus simplement celle de la vie bonne (pour moins alarmistes).
Le souci d’une politique globale du vivant apparait aujourd’hui comme une des dimensions fondamentales d’une pensée critique qui aurait vocation à proposer des mécanismes de partage équitable des ressources et de sauvegarde de la vie humaine sur Terre. Partant de la perspective des Amérindiens d’Amazonie, un auteur comme Philippe Descola en appelle à l’abandon de ce qu’il appelle une vision naturaliste du mondequi a conduit le monde occidental à réduire l’ensemble des entités naturelles (dans lequel les Africains ont souvent été rangés d’ailleurs) à une réserve inépuisable de biens et d’énergie.
Et lorsque l’on aborde de manière anthropocentrée la question de la vie, de la variabilité de ses formes, de ses conditions de possibilité biopolitique et de ses limites (jusqu’à quel point peut-on décemment rester vivant), l’Afrique se présente effectivement comme une masse colossale dont l’occultation risquerait de masquer la partie immergée de l’iceberg.
Dans une telle perspective, l’Afrique apparait comme un espace singulier qui donne à voir, sans fard, ce que le pouvoir peut faire de la vie et, plus particulièrement, ce que l’exposition prolongée à la brutalité des systèmes d’exploitation née de la Modernité a fait des différentes formes de vie sur ce vaste territoire.
Ce que penser l’Afrique veut dire
Achille Mbembe invite toute réflexion sur l’Afrique à se projeter vers quatre directions, de manière disjointe ou articulée. Penser l’Afrique, c’est :
1 Rétablir un nom. Combattre des préjugés séculiers nés de la pensée coloniale et impériale.
2 Ramener à la vie ce qui avait été abandonné aux puissances de la négation et du travestissement
3 Rouvrir l’accès au gisement du futur pour tous.
4 Contribuer à l’avènement d’un monde habitable.
Cette invitation appelle donc à tracer les contours d’un champ, certes déjà arpenté, mais pas encore totalement balisé. La présente proposition s’inscrit indubitablement dans les perspectives ainsi ouvertes, tout en gardant la dynamique propre qui la fonde :
- Symétrisation des formes du vivant
- Saisissement du devenir monde du monde dans un mouvement circulatoire
Ce qui importe donc, c’est que l’Afrique partage le Monde avec les autres, y compris cet agrégat abstrait que l’on appelle l’Occident. L’objectif de telles approches, tel qu’initiées par des intellectuels africains comme Valentin Yves Mudimbe, Souleymane Bachir Diagne ou Achille Mbembe, pourrait donc être la mise en exergue, l’amélioration et surtout la création de mécanismes de partage équitable du monde. C’est à ce prix seulement que le monde deviendra monde.
Ce n’est donc pas l’irréductibilité d’une expérience intérieure proprement africaine (quoique nous ne cherchons pas non plus à nier cela, ou du moins, les effets des récits différentialistes) qui structure cette discussion mais plutôt l’expérience fragmentée de la Modernité et la manière dont certaines de ces expériences peuvent nous informer davantage sur le visage de celle-ci, particulièrement lorsqu’elle se confronte au dissemblable. Cette méthodologie permet d’en faire le diagnostic le plus fidèle, à la fois pour la vie humaine que l’ensemble des entités du vivant.
L’Afrique, le Nègre et les Autres
D’emblée il faut également préciser que l’Afrique dont il est question ici ne se limite pas aux frontières de la géographie statique. En effet, l’Afrique et le Nègre constituent les deux mêmes faces d’une imagerie complexe construite par la Modernité comme différence de la différence, reflet inversé de la raison, située dans une sorte d’espace intermédiaire entre culture et nature.
Peut-être faut-il rappeler également que, sous le règne de la Modernité, certains phénomènes d’oppression d’ampleur subis par les Africains et/ou les personnes d’ascendance africaine ont également frappé d’autres communautés dont les traits physiologiques ne pouvaient pourtant être totalement capturés par la figure du Nègre, du fait de sa teneur en mélanine. Mais sans doute était-il encore possible à celles-ci de sortir de cet épiderme social et d’abandonner, dans le jeu des échelles sociales, cette peau sociale infâme.
Le Nègre est donc aussi cette assignation dont, certains, ont pu besogneusement se défaire. Les Africains et leurs descendants, moule dans lequel avait été produit cette figure monstrueuse, n’ont, en dehors de l’Afrique elle-même, aucune possibilité définitive de réellement s’extraire de cette clôture. Ainsi, plus de trois siècles après la fin de l’esclavage transatlantique, la possibilité pour eux d’échapper à cette figure reste dépendant de procédures socio-économiques complexes à l’issue incertaine et in fine fragilisées par une opposabilité toujours ouvertes. Qui que soit l’Africain ou l’Afro-descendant, l’interpellation de « sale nègre » au coin d’une rue reste toujours de l’ordre du possible et du plausible.
Le Devenir Nègre du Monde
L’une des spécificités de l’action de la Modernité sur l’Afrique, c’est cette opération à la fois pratique et intellectuelle qui a consisté à transformer des êtres humains en chose et à les réduire drastiquement en combustible pour la machine économique. Ce processus miraculeux par lequel un homme devient un bien meuble, pour le dire comme le Code Noir, marque durablement le rapport du corps noir à soi et sa circulation dans l’espace globalisé.
En cela, le Nègre aurait, selon Achille Mbembe, devançait le monde. En effet pour lui, les dernières formes du capitalisme financier ne tendraient qu’à élargir le plus possible ce geste de réduction miraculeux à l’ensemble du globe, y compris au monde occidental lui-même.
La modernité a produit une véritable métaphysique de la race, celle-ci naissant et venant alimenter d’abord la structure morale et discursive de légitimation de la traite de l’esclave atlantique puis ensuite le désir colonial tout autant que sa justification.
Césaire nous dévoile ainsi la véritable nature de la relation dans l’économie morale de la colonisation :
« Entre colonisateur et colonisé, il n’y a de place que pour la corvée, l’intimidation, la pression, la police, l’impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l’homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chiourme, en chicote et l’homme indigène en instrument de production »
Ce devenir Nègre du monde pourrait bien faire de l’Afrique un des rouages essentiels de tout nouveau chantier significatif d’une pensée matérialiste ayant pour projet une émancipation ouverte à tous les vivants. Ce repositionnement inattendue de l’Afrique n’est en aucun cas celle annoncée par les nouvelles forces carnassières du capitalisme financier. Celles-là ne jurent désormais que par ce qu’elles ont appelé « l’émergence » économique de l’Afrique, laquelle, si les responsables africains n’y prennent garde, pourrait bien ressembler à s’y méprendre à une recolonisation du continent, non plus par la forme classique des trois M (missionnaires, militaires, marchands) mais par du pur capital. Bis repetita.Ce qui nous intéresse ici est certainement plus fondamental, plus grand que l’Afrique elle-même d’ailleurs; c’est l’Afrique comme structure d’émancipation du seul monde souhaitable pour tous, c’est-à-dire un monde devenu monde.
Tabué NGUMA