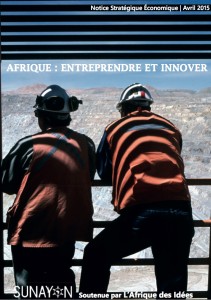Les énergies renouvelables ont le vent en poupe. Presque 300 milliards de dollars US ont été investis au cours de l’année 2015 dans le monde, soit autant que le produit intérieur brut de l’Egypte qui est la troisième économie du continent africain. En Afrique, les projets et initiatives fleurissent. Pourtant, ce relatif espoir ne lève pas les inquiétudes dans ce continent où le secteur de l’énergie connait une profonde crise avec un niveau de détresse élevé. Quelle approche choisir donc pour une politique énergétique efficace ?
Les énergies renouvelables ont le vent en poupe. Presque 300 milliards de dollars US ont été investis au cours de l’année 2015 dans le monde, soit autant que le produit intérieur brut de l’Egypte qui est la troisième économie du continent africain. En Afrique, les projets et initiatives fleurissent. Pourtant, ce relatif espoir ne lève pas les inquiétudes dans ce continent où le secteur de l’énergie connait une profonde crise avec un niveau de détresse élevé. Quelle approche choisir donc pour une politique énergétique efficace ?
Cet article s’inscrit dans le cadre de la préparation du Forum International sur le Green Business qui sera organisé à Pointe Noire du 17 au 19 mai 2016.
1. Insuffisance et inadéquation de l’offre
La problématique de l’accès à l’énergie, en Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, est complexe et demeure entièrement posée. L’accès à l’électricité progresse dans les zones urbaines mais à un taux inférieur à la croissance exponentielle de la demande. Cette progression est encore moins significative en zone rurale tant le coût d’extension des réseaux est onéreux face au consentement à payer des bénéficiaires. Nous avons mis en exergue dans un article traitant du financement de l’accès à l’énergie en zone rurale la complexité de couverture de l’étendue des territoires nationaux ; obligeant les décideurs publics à se tourner de plus en plus vers des solutions de proximité.
Les rapports Africa Energy Outlook (2014) et Power Tariffs de la Banque Mondiale (2011) indiquent que la consommation d’électricité en Afrique est fortement axée sur les secteurs résidentiels et les services. Les pays dotés de ressources fossiles concentrent une quantité non négligeable de leur production d’énergie thermique pour les consommations de base et de pointe pendant que les pays les moins dotés exploitent des unités de production à faible rendement à des couts très élevés. Une subvention étatique est souvent nécessaire pour rendre utile l’énergie électrique aux usagers finaux conduisant à une adoption massive de la tarification progressive par tranches avec une forte subvention pour les tranches de première nécessité.
Loin de satisfaire les simples besoins de base, l’offre énergétique en Afrique subsaharienne est insuffisante pour le besoin industriel entravant par le même effet l’industrialisation du continent. L’absence des résultats malgré les importantes allocations des ressources via les subventions, laisse penser que les approches adoptées ne sont pas les mieux adaptées.
2. Absence de vision et d’innovation ?
En effet pour répondre à la problématique de la crise énergétique, l’Allemagne autrefois leader dans la production de modules photovoltaïques a développé un marché gigantesque de l’énergie solaire, malgré l’irradiation peu élevée comparée aux pays du Sud. La France, depuis le choc pétrolier des années 70 s’est tournée vers le nucléaire avec des géants tels que Alstom ou Areva. La Corée du Sud, principal fabricant de méthanier grâce à Samsung a un avantage comparatif très avancé dans les infrastructures gazières plaçant ainsi le pays comme le second importateur de gaz naturel liquéfié après le Japon. Ces Etats ont développé des politiques stratégiques efficaces qui leur ont permis, au délà des technologies adoptées de créer des valeurs ajoutées importantes capable de répondre à des considérations sociales et techniques (emploi, brevets, retour d’expérience) sur le moyen et le long terme.
Malheureusement, les Etats d’Afrique subsaharienne sont loin de ce compte. L’espace subsaharien n’a pas intégré toute la chaine de valeur du marché de l’énergie et très peu de technologies sont développées pour le marché régional et local. La plupart des pays sont de simples consommateurs dont les populations s’adaptent sans cesse aux produits importés (lampes de 100W répandus sur les marchés, régulateur de tension pour pallier aux baisses de tension, transformateurs 110/220V et vis-versa pour faire fonctionner les équipements US-Chine-Europe, etc…).
Par ailleurs des nombreux rapports mettent en exergue par exemple le coût très élevé de l’énergie non fournie pour cause des récurrents délestages ou de son indisponibilité dans les zones rurales. Les formes actuelles de substitut semblent peu économiques et moins durables compte tenu des externalités négatives sur l’environnement et la santé (fumée du pétrole lampant, bougie, charbon de bois…). Des alternatives plus durables telles que les pico PV prennent une place de plus en plus importante mais demeurent limités quant à l’usage. Malgré une baisse drastique du prix du watt-crête, les installations solaires sont couteuses car leur déploiement répond à une logique de hors-réseau.
La crise énergétique que connait l’Afrique subsaharienne est due à une absence de vision politique en la matière. La solution passe par la création d’un véritable marché intégré d’énergie grâce à la technologie et à l’innovation.
3. Pour une approche intégrée
Pour que l’Afrique puisse résoudre sa crise énergétique, le développement du secteur se doit d’être intégré : intégré sur le plan technologique et social par le biais d’incubateurs, de centres de formation et de recherche et développement avant-gardiste des technologies du futur et créateurs d’emplois ; intégré sur les normes et règlementations car le continent ne peut continuer d’importer à foisons des produits souvent déclassés sous d’autres hémisphères.
L’avènement des nouvelles formes d’énergie offre une opportunité en terme de création de valeurs avec en prime une solution au chômage avec des corps de métiers allant de l’ingénierie, de la spécialisation environnementale et juridique, du génie civil aux manœuvres qualifiés. Les produits issus de cette révolution seront adaptés au marché local et régional et garantiront par des labels, un savoir-faire susceptible d’être exporté vers d’autres régions du monde où la question de l’énergie est loin d’être résolue.
4. Des solutions immédiates en attendant
Plusieurs sociétés en charge du secteur sont si endettées et non compétitives qu’elles ne sont pas en mesure d’attirer les financements octroyés. Au-delà des grandes réformes préconisées ci-hauts, des mesures concrètes sont pourtant à la portée des décideurs publics. Il s’agit entre autre d’instaurer des objectifs de performance périodique pour les dirigeants des sociétés étatiques en mettant en place par exemple des reports sur la quantité d’énergie fournie et la planification des délestages. Il s’agit également de restaurer l’image de ces sociétés par des campagnes de communication et de sensibilisation de tous les acteurs.
Grâce aux nouvelles technologies, les mécanismes de règlements des factures pourraient être simplifiés, les taux de recouvrement améliorés, le traitement des plaintes accélérés, les suggestions des usagers prises en compte. Grace à ces améliorations et en mettant en place un système de financement participatif via des banques populaires, les usagers eux-mêmes pourraient être incité à devenir actionnaires des leurs infrastructures énergétiques.
Leomick SINSIN